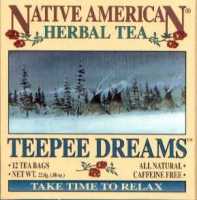LE NOUVEAU
TEMPLE
De loin, de très loin, à
travers les fanfares du vent d'automne, par-dessus les
rauquements, les apostrophes et les colères de dix
mille autos qui se querellent pour la place, on entend le
souffle du stade, ses clabauderies, ses
orages.
Une banlieue crasseuse, confuse, encombrée. Un grand
terrain vague et le stade que la foule occupe comme une
forteresse conquise. Ce n'est pas le Colisée, ni
l'amphithéâtre d' El
Djem si fier, là-bas, dans
la plaine altérée. C'est une bâtisse de
ce style qui s'avoue, cyniquement, utilitaire. Une
énorme et, dirait-on, frêle coquille de ciment,
ouverte face au ciel et que recouvre une couche grouillante
et grenue de chair humaine.
Nous avons passé les guichets, car le dieu de
l'endroit exige une assez lourde obole. Nous avons
cheminé dans des couloirs et des escaliers. Enfin
nous parvenons à l'air libre.
Voici la plus grande multitude qu'il m'ait été
donné de voir, rassemblée, rangée,
tenue en respect par un rite quasi religieux. Que sont , au
prix de celle-ci, les foules du théâtre ou du
concert, celles des réunions politiques, ou
même celles des églises, ou même celles
des cinémas ? En vérité, je
découvre ici l'un des temples de l'Amérique
moderne.
Quelle haute et noble pensée peut
amener en ces lieux un si grand concours de peuple ? Quelles
passions font grimacer tous ces visages, hurler toutes ces
gorges ? Quelles espérances ? Quelles haines ? Un
instant, je ferme les yeux pour sentir cette puissante foule
d'une façon plus interne, pour mieux percevoir ses
soupirs, ses élans de rage ou de joie, pour me
laisser non pas enivrer, mais tout au moins emporter,
rouler, bercer peut-être par cette vague
d'humanité. Puis, de nouveau, la lumière.
Éparpillés sur un gazon divisé par des
raies blanches, une trentaine d'hommes jouent au ballon.
Autant qu'il est possible de juger à la distance
où je me trouve, ce sont des hommes jeunes. Ils ont
le crâne protégé par un casque à
bourrelets, et de même les tibias par des
jambières à la romaine. Collées sur
leurs maillots, de larges étiquettes portant un
numéro d'ordre.
Ce n'est pas un jeu radieux, allègre, aérien ;
mais quelque chose de sombre, de farouche et de contenu. Une
trentaine d'hommes, à peu près, sur la
pelouse, en deux camps.
Ils s'immobilisent d'abord, assez longtemps, dans des
postures étranges. Ils semblent s' épier du
regard, tels des fauves à l'affût. Puis le
ballon s'envole. Alors une mêlée très
courte, confuse, d'une indicible brutalité.
Oh ! rien d'une danse harmonieuse, rien de la statuaire
grecque. Nulle élégance, nulle fantaisie et,
surtout, nulle beauté sinon celle, repoussante, qui
se peut découvrir dans une scène de
sauvagerie. Et, tout de suite, un coup de sifflet : la meute
s' immobilise, se contracte de nouveau, se reprend à
guetter sa proie, avant la nouvelle rixe.
Voilà ce que l'on voit sur la pelouse. Pour moi, pour
le profane impénitent, ce n'est pas là qu'est
le spectacle.
Le spectacle est sur les gradins, avec la foule. Combien
sont-ils ? Quarante, cinquante mille, peut-être plus,
je ne saurais dire. L'université de la ville a
défié l'université d'un État
voisin. Chacune des tribus, face à face, arbore ses
oriflammes. Garçons à droite, filles à
gauche. Le menu peuple achève de remplir le
gigantesque vaisseau : une foule
roturière, sans
caractère et sans mandat, qui n'est là, et qui
le sait, qu'en qualité de ballast, de
bourre
ou d'appoint. Une foule dans laquelle on pourrait
reconnaître et compter cinq cents fois le même
chapeau d'homme, gris à ruban noir, mille fois le
même chapeau de femme, le bleu, la forme, la cocarde,
tous les stocks imposés par l'industrie locale. Bref,
la foule, dans toute sa monotone horreur.
L'élément aristocratique de
l'assemblée, ce sont, aujourd'hui, ces
étudiants, avec leurs couleurs, avec leurs
orphéons aux instruments burlesques, avec leurs chants,
avec ces cris concertés que lancent les deux tribus
pour exciter les gens d'en-bas. Chaque groupe a son
capitaine, son chairman-leader .
C'est une enviable dignité. L'heureux titulaire est
pourvu d'un porte-voix de lutteur forain. Il commente, pour
la foule, toutes les phases du match, annonce le point ou la
punition ( que l'on appelle en français un
penalty ), déchaîne ou refrène les
enthousiasmes, provoque, par ses traits d'esprit ou sa
gesticulation, les réflexes du public.
Poudrées, fardées, les écolières
s'alignent sur les bancs de ciment, telles des brochettes de
perruches. De leurs gorges, encore vertes comme des pommes
de juillet, elles tirent des cris suraigus, perforants, que
l'on dit spécialement toniques pour les nerfs des
compétiteurs. La capitaine de ces demoiselles est une
assez belle personne. Elle arbore, m'assure-t-on, un des
noms les plus honorables de toute la contrée. Le
porte-voix au poing, la jupe au vent, elle hurle, elle se
démène, elle exécute avec furie une
suggestive danse du ventre, tout comme les
prostituées dans les ports
méditerranéens. De minute en minute, elle
rassemble sa volière et la convie au
glapissement.
Je ne connais pas ce jeu de ballon, fameux pourtant sur
toute la terre. Ce que font les forcenés,
là-bas, dans le cirque, me semble hors de mesure avec
ces vociférations indécentes. La plus grande
part du public n'en sait guère plus que moi, voit mal
ou ne comprend pas. Parfois, les oiselles partent à
contretemps, s'embrouillent, huent quand il faut applaudir,
approuvent quand il faut protester. Beaucoup papotent,
d'autres bâillent. Alors les orphéons se
déchaînent et couvrent de leurs mirlitonnades les piaillements de l'assistance. Puis les hordes
de jeunes mâles poussent, d'une seule voix, en
rythmant chaque syllabe, les maîtres-mots, les
maîtres-cris, les " slogans" de la tribu. Cependant
que, tête baissée, comme des fourmis furieuses,
les gaillards de la pelouse continuent à se disputer
rageusement le gros oeuf de cuir.
Que demande cette multitude ? Que viennent chercher, ici,
ces milliers d'hommes et de femmes ? Est-ce vraiment pour
observer cette dispute hasardeuse entre deux clans
d'écoliers que tout ce peuple accourt, patiente,
donne de l'argent, et trépigne sur les gradins, dans
la soirée fraîchissante ?
N'est-ce pas plutôt, ô grande foule, pour te
griser de toi-même, de ta propre voix, de ton propre
bruit, pour te sentir nombreuse, chargée de
puissance, d'effluves, pour goûter aux délices
mystérieuses des grands troupeaux, des bancs de
poissons, des essaims, des fourmilières ?
Et puis, qu'est-ce que c'est que ce sport où
vingt-cinq gaillards s'essoufflent, pendant que quarante
mille bougres, immobiles, attrapent des rhumes, fument la
cigarette et ne donnent d'exercice qu'à leurs cordes
vocales ? Vrai, cela me fait songer aux gens que l'on dit,
chez nous, de fervents sportsmen
, de distingués
sportsmen
, parce que, deux fois la
semaine, ils vont voir galoper des chevaux et perdre
quelques centaines de francs avec la complicité des
pouvoirs publics.
Je ne suis pas de ces clercs quinteux,
économes de leurs muscles, paresseux ou timides, que
tout effort physique inquiète et décourage.
J'ai parcouru la moitié de l'Europe à pied et
le sac au dos. Je sais, comme tout homme raisonnable, nager,
aller à bicyclette, conduire une voiture, tenir une
raquette, voire un aviron. J'ai, pendant des années,
battu le sol des salles d'armes pour infliger quelque
fatigue à ma carcasse de citadin. J'entends bien que
mes trois fils seront agiles, adroits, robustes, si la vie
me prête assistance. Je ne dédaigne pas
l'exercice corporel : je l'aime, je le recommande, je le
souhaite souvent, au fond d' une retraite trop studieuse.
Mais cette comédie du sport avec laquelle on berne et
fascine toute la jeunesse du monde, j'avoue qu'elle me
semble assez bouffonne.
Dans la mesure même où il participe de
l'hygiène et de la morale, le sport , acceptons le
terme puisqu'il a forcé notre vocabulaire , le sport
devait être, avant tout, une chose personnelle,
discrète, ou même un jeu de libres compagnons,
une occasion de rivalités familières et
surtout, comme disait le mot avant ses aventures modernes,
un plaisir, un amusement, un thème de gaieté,
de récréation. Le sport, entre les mains de
traitants ingénieux, est devenu la plus avantageuse
des entreprises de spectacles. Il est , corollaire
obligé, devenu la plus étonnante école
de vanité. L'habitude, allégrement acquise,
d'accomplir les moindres actes du jeu devant une nombreuse
assistance a développé, dans une jeunesse, mal
défendue contre les chimères, tous les
défauts que l'on reprochait, naguère encore,
aux plus arrogants des cabotins. Il s'est fait un bien
étrange déplacement de la curiosité
populaire. Quel ténor d'opérette, quel
romancier pour gens du monde et du demi-monde, quel virtuose
de l'éloquence politique peut se vanter, aujourd'hui,
d'être aussi copieusement adulé,
célébré, caricaturé que les
chevaliers du "ring", du stade ou de la piste ? Et je ne
parle pas des princes, des spécialistes
exceptionnels, des inventeurs, de ceux qui ont des traits
d'inspiration, créent un genre, une tradition, se
montrent, en quelque mesure, grands par la patience, le
courage, la grâce ou la fantaisie. Non, je parle de
ces honnêtes garçons qui font correctement les
gardiens de but, courent assez bien les cent mètres,
savent pédaler longtemps et qui ne peuvent plus
ouvrir un journal sans y chercher de l'oeil leur profil et
le récit de leurs exploits dominicaux. Je parle de
ces gentils compagnons qui, dès l'enfance,
chérissaient la force, la souplesse, le beau jeu,
l'acte élégant et difficile, de ces bons gars
que l'on a, petit à petit, gâtés
d'orgueil, engagés dans des concurrences absurdes,
livrés au pire des publics, celui du cirque,
enivrés d'une gloire grossière, perfide,
bientôt plus nécessaire que l'alcool. Je parle
de tous ces enfants que l'on disait avec juste raison des
amateurs parce qu'ils aimaient quelque chose, et que l'on
voit se transformer bien vite en sportsmen de
métier, vaniteux, cupides, que la moindre
défaveur aigrit et dévoie, qui cessent d'aimer
leur plaisir dès qu'il devient un gagne-pain.
L'ambition, sans doute noble en soi de briller au premier
rang, pousse un grand nombre de jeunes hommes à
réclamer de leur corps des efforts auxquels ce corps
paraît peu propre. Le sport n'est plus, pour beaucoup,
un harmonieux amusement, c'est une besogne harassante, un
surmenage pernicieux qui excède les organes et fausse
la volonté. Trop vite spécialisé, l'
athlète ne se développe pas dans un heureux
équilibre. Il accuse les stigmates, les
déformations et les laideurs où se marque tout
excès professionnel.
Dès que les compétitions perdent leur gracieux
caractère de jeux purs, elles sont
empoisonnées par des considérations de gain ou
de haines nationales. Elles deviennent brutales, dangereuses
; elles ressemblent à des attentats plutôt
qu'à des divertissements.
Les jeunes hommes qui prennent, sur leur loisir ou sur leur
ouvrage, le temps de cultiver un de ces sports exigeants que
soignent les hommes d'affaires avec leur attirail de presse
et de gloire, ces jeunes gens risquent de compromettre une
carrière substantielle pour une brillante illusion.
Quel saint, ayant à choisir entre un emploi obscur
dans quelque ministère et l'espoir d'être un
jour capitaine de football, garderait la
sérénité? Qui ne lâcherait
l'austère proie pour l'ombre enivrante ?
Dans le dessein de pousser notre jeunesse française
à ce culte des sports, on a fait jouer les plus
vénérables ressorts. On a dit que la patrie
menacée, appauvrie, peut avoir besoin, quelque jour,
d'une jeunesse endurcie, trempée par les jeux de
force et d'adresse. L'argument est sans valeur si l'on s'en
rapporte à l'histoire. La grande guerre fut faite, en
France du moins, par des paysans, des employés, des
ouvriers, des bourgeois, des intellectuels, sans culture
sportive pour la plupart et qui, pendant près de cinq
ans, ont montré des vertus physiques et morales
dignes de considération. En revanche, certains
princes du sport n'ont même pas compromis leur
grandeur dans les misères de la troupe.
Entre tous les griefs que soulève cette curieuse
querelle, on ne saurait passer sous silence
l'éternelle question du langage. Les professionnels
du sport ont acclimaté, chez nous, un jargon
ébouriffant, presque intraduisible, farci de mots
étrangers, employés hors de propos,
prononcés de façon comique, engagés
dans des métaphores que le bon sens désavoue,
je ne parle pas du bon goût...
Au lendemain de la guerre, nombre d' écrivains ont
fait une généreuse tentative pour doter le
sport d'une littérature lisible. Grand dessein, assez
vite abandonné. Le public lettré n'a pas
encouragé ces effusions olympiques. Pour le public
des stades, il se moque bien des belles-lettres. Quant aux
acteurs des orgies musculaires, ils sont grisés d'un
encens tout autre que celui des jeunes romanciers ; ils
n'ont même pas ouvert les livres qui
célébraient seulement la chose et ne nommaient
pas toujours les gens. Comme on écrit, somme toute,
dans l'espoir de se faire lire, les poètes,
désappointés, ont restitué le sujet aux
journalistes spéciaux.
Hélas! Hélas ! jeunes gens de France, n'
étais-je pas en Amérique? N'étais-je
pas, tantôt encore, dans le grand stade tout pareil
à quelque cratère de béton, parmi les
girls glapissantes, les orphéons
d'étudiants, la foule déchaînée ?
Est-ce bien ma faute, ce soir, si mes reproches passent la
mer ?
Georges DUHAMEL
Scènes de la vie
future
chapitre XII, LE NOUVEAU
TEMPLE
pages 90 à 96
Ed. Fayard, coll. "Le livre de demain", juillet 1934
     Vers la page "Nouveaux
Mondes" pour les netscapiens
Retour
à la pelouse pour les
passagers de NETSCAPE
Retour au
Tableau
( Explorer
MAC / PC
)
Vers la page "Nouveaux
Mondes" pour les netscapiens
Retour
à la pelouse pour les
passagers de NETSCAPE
Retour au
Tableau
( Explorer
MAC / PC
)
Retour à l'accueil
|














 Le VOYAGE au 20è
siècle
Le VOYAGE au 20è
siècle