
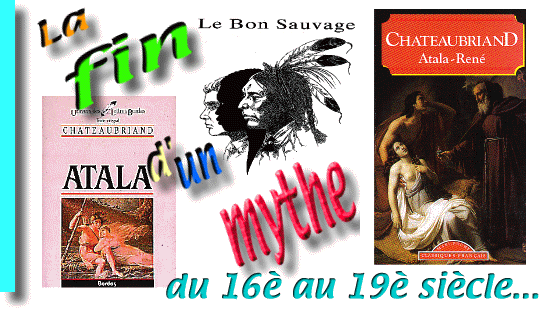
|
Photos. Yves Clady ©Copyright 2001  |

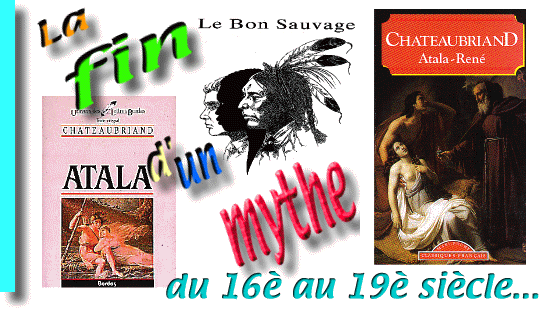
|
Photos. Yves Clady ©Copyright 2001  |
|
|
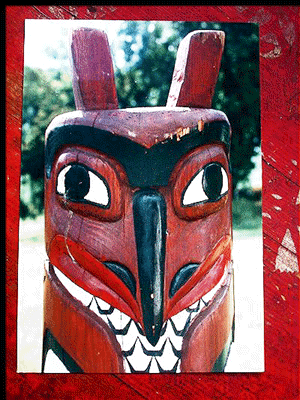


|

|
 ..........
..........
|
|
Enquête littéraire 
|
|
.........Site intéressant et complet sur les 
|

|
|
|

|
|
|
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 . .
|
|