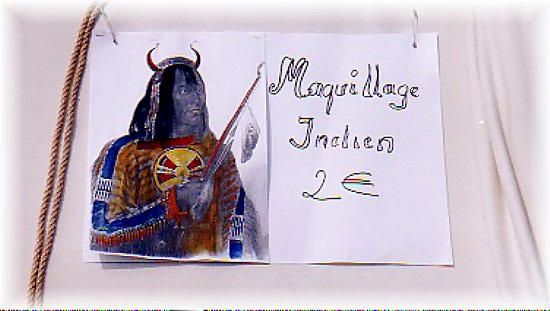|
VOUS
AVEZ DIT
"SAUVAGES" ?.. page
2 / 7
|

|
Lettres à un éditeur d'aujourd'hui à propos d'un
écrivain d'hier ...
|
Celui-Qui-Plane-Au-Dessus-Des-Nuages........................
Tribu de
Caughnewagas............Québec
|
.........A Mr l'éditeur de la
collection Pléiade
......... 3 Avenue des Champs
Elysées,
......... Paris / France
|
Bonjour
Monsieur l'éditeur,
Je vous rédige
cette lettre pour vous faire part de mes impressions, face
aux textes de Chateaubriand
que vous avez publiés.

|
Je pense que
Chateaubriand, malgré le fait qu'il est
européen, s'est bien renseigné sur la
culture des indiens ainsi que sur leurs traditions.
Ses textes décrivent bien nos
manières ancestrales de nous marier, de
faire la guerre, de chasser, mais je trouve que
l'emploi du mot "sauvages" est abusif et
démesuré. Abusif car c'est le seul
terme qu'emploie Chateaubriand pour nous désigner. Nous
autres, les Indiens d'Amérique, sommes des
êtres humains ayant une civilisation, certes
différente de la vôtre, mais nous
sommes vos égaux et non vos
inférieurs. Nous pratiquons la chasse et la
pêche pour vivre, vous le faites pour vous
distraire et vous divertir. Si les Européens
pensent que les Indiens sont des sauvages, alors
qu'ils aiment et respectent la nature, les
Européens qui saccagent les forêts et
polluent les rivières sont encore plus
sauvages que nous.
|
Si être "sauvage"
signifie pour vous vivre en symbiose avec la nature, nous le
sommes en effet.
Cependant, pour nous, le terme
"sauvages" désignerait plutôt ceux qui
saccagent la nature, ce qui vous concernerait
déjà plus, vous, les blancs. C'est également ce que souligne
Montaigne, qui utilise le terme "sauvages"
à notre avantage, en dénonçant la
bêtise des Européens. Vous
connaissez désormais ma façon de penser et
j'ai été très gentil.
Je ne vous salue
pas,
Celui-Qui-Plane-Au-Dessus-Des-Nuages
|
Monsieur,
Je vous
écris pour vous faire part de ma
pensée à propos de l'oeuvre de
M. de
Chateaubriand que vous
avez publiée. En effet, j'ai
été agréablement surpris de la
précision et de la fidélité
avec lesquelles cet écrivain évoque
nos coutumes passées. Je souligne ce point
car je crois que nos coutumes, nos rituels, font
partie de notre histoire et il est important que
l'on sache comment vivaient mes ancêtres. Je
le félicite pour cela ...
Toutefois, un
détail me contrarie fort. Tout en
avançant dans ma lecture, j'ai
constaté avec consternation que l'image des
mes aïeuls prenait la forme de guerriers
sanguinaires non-civilisés. M. de Chateaubriand utilise sans cesse le mot "
sauvages " pour nous décrire. Mais
n'étions-nous pas plus que des "
sauvages " ? Nous étions des
êtres humains, après tout,
peut-être moins "avancés" que vous
dans nos moeurs et par rapport à la "
technologie " de ce temps, car nous vivions
très près de la nature. Nous en
prenions soin et il aurait été
inconcevable pour nous de détériorer
celle-ci comme vous, les "Blancs", le faisiez
à l'époque de Chateaubriand.. Aucun des nôtres ne
méritait d'être qualifié de la
sorte.
Et cette manie
d'exagérer nos rites vis-à-vis de nos
ennemis et des animaux que l'on tuait !
|

|

|
Certaines
personnes pourraient nous croire beaucoup plus
insensibles que nous ne l'étions. Certes, le
fait que nous scalpions les ennemis vaincus
pourrait sembler quelque peu "barbare". Mais du moment que ceux-ci
étaient morts, pourquoi ne pas rapporter une
preuve de notre victoire ? Quant aux animaux, il
fallait bien se nourrir. Cela ne posait pas de
problème puisque nous leur réservions
un rite pour que leur âme repose en
paix.
Pour revenir au
terme " sauvages ", nous avions pu
bénéficier des bienfaits de la nature
pendant que vous, vous vous évertuiez
à la détériorer.
|
Pourquoi nous appeler "
sauvages " alors qu'il n'y avait pas plus pacifistes
que nous sur terre ? Il est normal, vous le concevez
sûrement, que si quelqu'un vous attaque, vous
ripostiez !
En conclusion, je dirai
qu'il est inadmissible qu'un tel mot soit employé
pour désigner un être dont le seul et unique
tort est de vivre dans la nature différemment de
vous.
Je vous fais part,
monsieur, de mes salutations distinguées.
Mahawi

|
Québec, le 11
septembre
Cher
Monsieur,
Je me permets
de vous écrire afin d'attirer votre
attention sur quelques unes des réflexions
que je me suis forgées après la
lecture du
Journal de Voyage
de Chateaubriand. Ne pouvant faire part de ces
pensées à l'auteur lui-même, je
laisse le soin à vous, éditeur de la
collection
Pléiade, de
lire ces quelques lignes.
Moi-même
indien du Québec, j'ai retrouvé à
travers cet ouvrage un grand nombre de nos
coutumes, rituels et procédés.
L'auteur permet à ses lecteurs de
s'imprégner d'une partie de la culture
indienne. A travers ses lignes, il fait voyager
l'intéressé au coeur de la
civilisation indienne en lui révélant
notre mode de vie. L'on peut alors apprendre avec
quel intérêt nous chassons l'ours,
comment nous célébrons le mariage ou
encore comment nous déclarons la guerre
à autrui. La description des personnages
permet aussi de mieux nous "visualiser". Tout cela permet donc de
dévoiler les nombreuses pratiques de la vie
indienne.
Cependant, nous
qui sommes très hospitaliers, ne voulons
peut-être pas tous faire connaître au
reste du monde certains faits ; ou alors nous
souhaiterions que certaines coutumes soient plus
amplement expliquées. En effet, la
description de traditions comme le scalpage n'est
pas, à mon avis, assez
développée. Cette pratique qui, j'en
suis d'accord, peut choquer beaucoup de personnes,
est tout simplement "expliquée" en deux ou
trois lignes... Mais aucune de nos raisons d'agir
n'est clairement formulée, si bien que nous
passons pour des barbares que nous ne sommes
point.
|
Par ailleurs, j'ai
particulièrement désapprouvé l'emploi
du terme "sauvages" durant la lecture de cet ouvrage.
Qu'est-ce qui nous semble "sauvage" ?
Tout ce qui ne nous ressemble pas et n'agit pas de la
même façon. Or, si l'on vous désignait
par ce mot, je doute que vous l'appréciiez. Personne,
dans le monde, n'a la même façon d'agir et de
penser - mais, pour notre part, nous ne traitons pas pour
autant les autres de "sauvages"...
Nous menons certes une
existence bien différente de la vôtre et je
suis tout-à-fait pour un brassage des cultures, mais
il faudrait pour cela savoir aussi respecter nos
différences et ne pas appeler "sauvage" une
personne qui ne l'est pas. En effet, si l'on
considère bien les réalités, nous
sommes tous étrangers car chaque être humain
est unique.
Sincères
salutations,
Fitiko
SHOURAN

|
Cher
monsieur,
je me
présente : je suis Chien-Jaune, fils cadet de Cheval-Blanc, chef de la tribu des
Pieds-Plats. Suite à ma
découverte du Journal de voyage écrit par M. de Chateaubriand, je me permets de vous faire part
de mes sentiments sur cet ouvrage et son auteur.
J'appréhendais cette
lecture. Vous comprenez, découvrir l'opinion
des Européens à notre sujet est
toujours un peu troublant.
Puis, j'ai
trouvé cela très intéressant :
je pense, en effet, qu'il est très
instructif de découvrir les coutumes
d'autrui, parce que la connaissance de l'autre est
très enrichissante pour
soi-même.
|
C'est pour cela qu'une
rencontre avec M. de Chateaubriand
serait opportune... Nous pourrions notamment converser du
terme "sauvage", car je crois qu'en France ce terme est
péjoratif, puisque vous appelez "sauvages" tous
les peuples dits "non-civilisés".
Or, à travers ce
journal, M. de Chateaubriand
démontre le contraire.
D'ailleurs j'ai été agréablement
surpris. Les coutumes décrites par votre
"journaliste" sont véridiques, mais j'aimerais
cependant corriger une grande erreur. M. de Chateaubriand a rapporté dans son journal les
coutumes d'une seule tribu, les Pieds-Bleus. En effet, la plupart de ces coutumes sont
communes à toutes les tribus. Cependant, il existe
quelques dissemblances entre elles.
|
Ainsi, chez
nous, la demande en mariage est un peu
différente. Les jeunes filles et les jeunes
hommes n'accompagnent pas respectivement la future
femme et son futur conjoint, mais c'est la
mère - ou à défaut une soeur -
qui conduit le fiancé jusqu'à la
hutte du chef de village. Ce dernier est à
la fois notre patriarche et notre prêtre. Les
fiancés doivent avoir son consentement,
avant celui des parents.
|
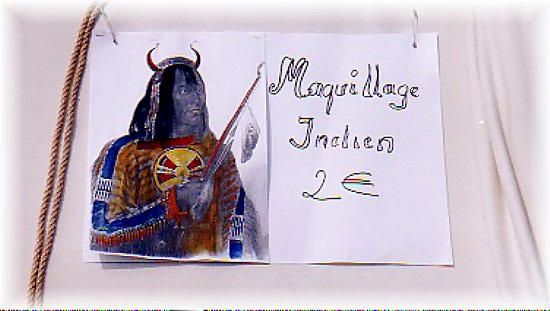
|
Arrivés dans la
hutte, les femmes s'assoient à gauche et les hommes
à droite, car, chez nous, la gent féminine est
séparée des hommes. Une seule femme
"échappe" à cette règle :
l'accompagnatrice du futur époux. Ce cas est
exceptionnel : c'est le seul moment dans toute la vie d'une
femme où celle-ci peut s'y résoudre. Nous
pensons effectivement que lors de ces occasions importantes,
les femmes et les hommes ne doivent pas être
perturbés par le sexe opposé assis à
proximité. Cette coutume est propre à notre
tribu.
Ainsi, je vous propose
de collaborer avec M. de Chateaubriand pour examiner de plus
près les principes et coutumes de ma tribu, comme
celles de nos "frères". En effet, je tiens à
préciser l'indépendance de toutes les tribus,
qui ne forment pas un seul Etat. C'est un peu comme dans la
Grèce antique.
Dans l'attente d'une
réponse de votre part, je reste à votre
entière disposition et vous prie d'agréer,
Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées.
Chien-Jaune
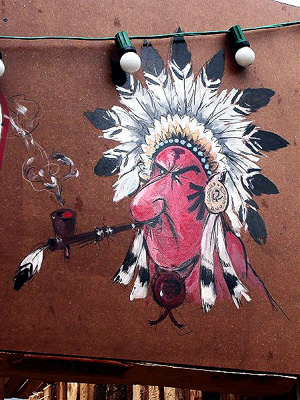
|
Cher
Monsieur,
Je viens de
finir la lecture du Journal de Voyage en
Amérique
de Chateaubriand, édité par
vous-même, et j'aimerais vous faire part de
mon bouleversement. Ce livre m'a marqué de
façon indélébile.
En effet, je ne
vous cache pas les sentiments forts que j'ai
éprouvés lorsque je
redécouvris par ces textes mes racines, mon
peuple et que je me redécouvris
moi-même. Je tiens vraiment à
souligner la véracité de ces
récits, car j'ai reconnu là les
histoires que mon grand-père partageait avec
moi, dans mon enfance. Il fut membre d'une tribu
indienne et vécut du début à
la fin la colonisation de ses terres. Et c'est avec
beaucoup de précision que j'ai
retrouvé son histoire dans ces
écrits.
Mais j'aimerais
en venir à un point qui m'a vraiment
révolté. Chateaubriand fait usage, dans le but de
désigner les Indiens, du mot "sauvages". C'est en effet un terme
très insultant qui rabaisse les Indiens et
fait passer l'Homme blanc pour un être
supérieur. En fait, ce sont bien les blancs
qui, pour voler des terres, ont
échangé des vêtements porteurs
de maladies dans le but de créer des
épidémies au sein des peuplades
indiennes. C'est bien la tribu entière de
mon grand-père, femmes et enfants compris,
qui a été massacrée par vos
valeureux "cow-boys"...
|
C'est pour cette raison que
je vous prie d'intégrer, dès lors, dans votre
édition, une note portant sur la signification du mot
"sauvage", soulignant bien le fait que "sauvage"
désigne ici des hommes qui vécurent jusque
là loin de la civilisation occidentale et de sa
violence, pourrais-je même dire "barbarie", et
qui vivaient près de la nature avec une philosophie
qu'il faut absolument reconnaître, respecter, et
peut-être même apprendre.
En vous remerciant
d'avance pour votre compréhension.
Tageronetec
Tileago, descendant de la
tribu des Towonegawas
Québec, le Jeudi 11 septembre
2003
Monsieur,
après avoir lu un
ouvrage de M. de
Chateaubriand, en l'occurrence
son Journal de voyage en
Amérique, je tenais
à vous faire part de mes impressions que je pense
utiles puisqu'elles sont celles d'un homme directement
concerné.
|
Faisant
moi-même partie de la tribu des
Iroquois, ce texte m'a atteint
personnellement et blessé
profondément. L'auteur emploie en effet
à répétition le mot
"sauvage" pour décrire notre tribu
et mes semblables Indiens.
Certains
passages sont, je l'avoue, assez flatteurs,
notamment quand M. de
Chateaubriand nous
décrit dans la première partie de son
récit comme étant des hommes
robustes, très braves et musclés.
Mais je pense que ce n'est en réalité
qu'un moyen d'appuyer sur le fait que nous pouvons
être très dangereux, en le
démontrant ensuite dans son récit !
L'auteur parle très
précisément de nos us et coutumes et
décrit très bien la demande en
mariage ou le mariage lui-même, dans notre
tribu, par exemple.
Pourtant,
chaque partie de son récit contient au moins
une fois le mot "sauvage" et l'auteur y décrit avec
un certain dédain des coutumes que vous,
Blancs, Européens, ne comprenez pas ! Il y a
dans son écriture comme une pointe de
dégoût quand M. de Chateaubriand explique, par exemple que nous
attachons un chien à un arbre pendant la
chasse ! Oui, il explique que c'est une offrande,
mais, au lieu d'insister sur ce fait, il montre
surtout que le chien crève dans d'atroces
souffrances. Pourquoi ne précise-t-il pas
que vous, Européens "civilisés",
pratiquiez le sacrifice il y a peu ?
|
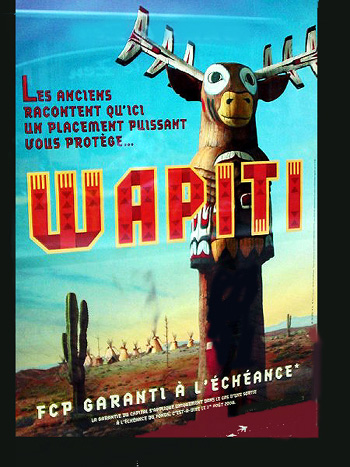
|
Il en va de même
lorsqu'il parle de nos guerres qu'il décrit comme
étant cruelles, horribles, ou bien de la chasse
à l'ours - en précisant bien les jeux qui nous
servent à fatiguer l'animal. Mais a-t-il conscience
que toutes les guerres sont horribles et
dénuées de sens précis quand elles sont
vues de l'extérieur ? Quant à la chasse
à l'ours, les aristocrates européens ne
pratiquent-ils pas la chasse à courre, qui consiste
à poursuivre un animal jusqu'à
épuisement de ce dernier ?
Toutes ces
justifications lui donnent-elles le droit de nous traiter de
"sauvages" ?
Je tiens en dernier lieu
à préciser que ce ne sont pas les Indiens qui
sont arrivés en territoire inconnu mais
peuplé, ce ne sont pas eux qui ont coupé des
arbres, construit des routes bétonnées,
détruit la flore ou encore chassé sur des
terres sacrées ! Ce ne sont pas eux non plus qui ont
fait signer de faux accords et traités, ou qui ont
voulu convertir une population entière à un
autre mode de vie, à une autre religion...
C'est vous, les Blancs,
les Européens, qui êtes des "sauvages", si
je puis dire.
C'est pourquoi je vous
demanderai de prendre en compte mon témoignage pour
éviter de continuer à publier cet ouvrage qui
détruit l'honneur des Indiens !
Salutations
distinguées,
Magomawak
|
Monsieur
le Directeur de la collection
Pléiade,
j'ai eu le
privilège de lire certains textes de
Chateaubriand extraits du Journal de voyage en
Amérique
publié dans votre maison d'édition -
et j'aimerais à présent vous faire
part d'une certaine révolte qui
m'anime.
Tout d'abord,
il me faut vous dire que si ces écrits m'ont
tellement touchée, c'est parce que je suis
moi-même d'origine indienne.
Le
deuxième soleil du mois des fleurs est le
jour de ma venue au monde, dans la tribu iroquoise.
Après avoir longuement remercié les
Dieux, ma mère m'a baignée de vent et
de soleil. Ma plus tendre enfance a
été bercée de chants, au
rythme du tambour. On m'a toujours appris à
remercier notre Mère Nature par des
offrandes ou des prières. Et, en
grandissant, j'ai su mesurer la sagesse de mon
peuple - ô combien précieuse !
Certes, toute
civilisation a ses défauts, mais certaines
plus que d'autres ! Par cette phrase, je ne me
permets pas d'insulter votre culture
européenne, mais simplement d'émettre
une critique. Je ne le fais pas gratuitement,
contrairement à nombre de vos compatriotes,
mais parce que je pense que c'est important. Ce que
j'essaie de vous dire, c'est que j'ai
été choquée par le terme de
"sauvage" utilisé dans les textes.
Je suis parfaitement consciente qu'au XIXè
siècle, il s'agissait d'un mot plus ou moins
neutre. Hélas, au XXè siècle,
il a une connotation péjorative. Pour des
personnes sans instruction, le terme "sauvage" désigne un être non
civilisé, cruel païen... C'est un mot
qui fait peur.
|

|
Avez-vous alors
réfléchi à l'image que ce terme nous
confère ? Sommes-nous réellement des barbares,
des cannibales ? Je veux bien admettre que notre peuple
était avant tout guerrier, comme on le voit dans les
textes intitulés
L'Iroquois et la
Déclaration de
guerre, mais tout de
même ! Notre peuple n'est pas plus sanguinaire que le
vôtre !
C'est pourquoi je vous
demande, si vous en avez la possibilité, de
préciser, en deux ou trois lignes, que le terme
"sauvage" n'était pas compris de la
même manière que de nos jours, à
l'époque de l'auteur. Merci de prendre en compte ma
requête...
J'espère que le
Grand Esprit
vous sera favorable et je
vous prie d'agréer mes sincères
salutations.
Atala
D'autres lettres fournies sur papier - et non sur
disquettes, comme prévu - paraîtront d'ici
quelques jours... le temps de les mettre en page...
Donc, à
suivre... avec de nouvelles
photographies ( cliquez )
prises aux
journées "country" de Fort Rio - Ostwood ( alias
Ostwald )...

|
Extraits du
Journal de Voyage en Amérique, de Chateaubriand
Michel Eyquem
dit "Montaigne" : vous avez dit "barbares" ?
Textes
rédigés par les élèves
de la Seconde Canada 2003 -
2004...
Lycée
Saint-Etienne... STRASBOURG
Séquence de Français
n° 1 :
regards sur
l'altérité... Démontrer, convaincre,
persuader... Septembre / Octobre 2003
Reportage .Photos. Yves
Clady ©.Copyright août 2003
courriel
clady@noos.fr
S U I T E ( galerie photo
complémentaire )...
|
"Couvrir" ATALA ... Le langage des jaquettes ...
Vers d'autres
écrits d'invention de la Seconde Canada
2003-2004
MAUDITS
SAUVAGES
(clic)
|